
Ils font partie de ceux qui ont vu leur ciel leur tomber sur la tête un matin de mai dernier : « Les villageois sont venus me voir un jour pour me dire qu’ils allaient chasser les clandestins et les occupants illégaux. Or, je n’étais pas clandestine, et je payais un loyer, ils m’ont donc dit ‘ça ne te concerne pas’. J’étais rassurée. Mais ils sont venus d’un coup, ont détruit ma maison, ont pris tous mes vêtements. Je n’ai plus rien », la voix mollit, Raïssat résiste aux larmes. Ils veulent témoigner anonymement, avec des prénoms d’emprunt.
Car ce sont deux représentants d’une condition dont ils voudraient sortir, « les hébergés des Bengalis » qui sont devant nous. S’ils viennent témoigner à nouveau, c’est pour alerter sur l’absence de scolarisation des enfants, 66 sont concernés, dont la majorité dans le premier degré. « Dans le second degré, c’est un chemin de croix tous les jours », témoigne Salim Soumaïla, « ils se lèvent à 2 heures du matin aux Bengalis, pour se rendre à 3 kms de là au ramassage, et arriver à l’heure dans leurs collèges du sud. »
« Nous nous lavons dans la rivière »

Un après-midi, une femme s’est fait agresser justement sur la route des Bengalis, alors qu’elle était avec son mari : « Ils sont tombés sur des bandits qui lui ont cassé le poignet à coup de bâton, et arraché le sac pour lui prendre son argent. Envoyée aux urgences, et plâtrée, puis déplâtrée, elle ne peut actuellement pas soulever son fils de un an. »
Si Salim Soumaïla témoigne c’est pour dire sa lassitude : « Ils avaient dit, on chasse les étrangers. Or, je louais 50 euros par an un champ pour cultiver et vendre mes bananes, ce qui me permettait de payer mon loyer de 70 euros à Majimeoni. Mais là, nous sommes parqués aux Bengalis, avec un seul WC pour 135 personnes, et nous nous lavons et lavons nos affaires dans la rivière. » Non loin d’une citerne Sogea.
S’ils ont des repas servis, ils affirment qu’ils étaient mieux avant, « nous étions mieux logés », et Raïssat nous montre les armoires imposantes, et les meubles qui agrémentaient son banga, « tout a été détruit. » Ils ont essayé de revenir sur leur village, mais les habitants les ont chassés.
Respect de la loi

Ce changement de climat à Mayotte, ils ne l’avaient pas anticipé, ni lui qui est sur le territoire depuis 1996, ni elle qui y vit depuis 1999, « si nos cartes de séjour n’étaient pas temporaires, nous partirions loin de Mayotte. » Mais pas de retour vers les Comores envisagé par contre.
Ce qu’ils demandent avant tout, c’est de pouvoir prolonger leurs cartes de séjour ou leurs récépissés. Mais pour cela, il faut une adresse : « Il faut que le préfet demande aux habitants de nous laisser revenir, et vivre selon les règles de la loi. Les makis de l’îlot M’bouzi étaient mieux protégés par le droit que nous ! » Lui a trois enfants scolarisés à Mayotte.
Ils déplorent le manque d’’activités pour les enfants, « pas de télé, ni de radio », et quand nous les interrogeons sur ce qu’ils ont mis en place eux-mêmes, ils expliquent que malgré tout, « les enfants suivent l’école coranique tous les matins. Mais on ne peut rien mettre en place car le site est plein de dangers pour des jeux d’enfants.»
Ils sont nostalgiques de la vie qu’ils avaient jusqu’au mois de mai, et ne comprennent toujours pas les raisons qui les ont chassés hors de leur village avec leurs enfants.
Anne Perzo-Lafond
Le Journal de Mayotte














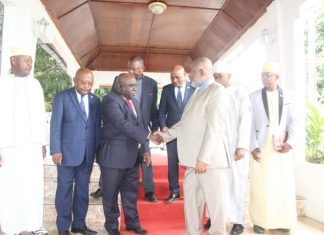



Comments are closed.