On est averti à Mayotte, ce n’est pas parce qu’une animation est annoncée qu’elle se tiendra, et même si vous appelez avant. C’était le cas de l’atelier de construction d’un banga traditionnel à Poroani, sur le site d’Antana Be. Au « village » d’Antana Be devrions-nous dire, puisque si tout est rasé et qu’il ne reste que quelques fondations, c’est une centaine d’âmes qui vivait en bord de mer de cette localité au nord de Chirongui.
Si des tentes des JEP ont été proprement dressées, et des plats au manioc, ou à la farine de riz étaient proposés aux visiteurs, ils étaient peu nombreux sur place, et personne pour nous montrer les gestes ancestraux d’érection des bangas. « L’association qui en était chargée n’est pas venue », nous explique un homme qui semble connaître le coin. Et nous ne tarderons pas à comprendre pourquoi.

Il commence par nous montrer un amas de terre, légèrement plus élevé que le sol, « c’est là que je suis né ». Devant notre étonnement, il nous explique que jusqu’en 1995, un village actif s’étalait alors : « Notre maison était en tige de raphia, très résistante à des vents très forts. Et quand elle a été détruite, l’ossature en bois était très saine, rien n’était pourri ». En 1993, explique-t-il, la mairie a mis en place sur cette zone un programme de Résorption d’habitat insalubre (RHI), et a déménagé tout le village, « j’avais 15 ans, et je reste nostalgique, j’y retourne tous les week-ends ».
Non seulement le village était très peuplé, mais il y avait un petit commerce d’alimentation et de produits de première nécessité, « la plupart n’avaient pas d’argent pour payer, donc on échangeait du coprah contre du savon par exemple ». Du troc qui a perduré jusque dans les années 70, rapporte-t-il. C’est marée basse, et il montre d’un geste large la zone d’estran d’où la mer s’est retirée, « là aussi s’érigeait le village. La mer ne venait pas jusqu’ici. » Un retrait du trait de côté inexpliqué selon lui.
La légende tronquée des cases en raphia

Il n’y a pas que la RHI qui a tué l’esprit du village, « le problème à Mayotte, c’est la télé. Au départ, il n’y en avait qu’une, branchée grâce à un groupe électrogène, tout le monde envahissait et salissait la maison du propriétaire. Puis, chacun a eu la sienne et ne parlait plus à ses voisins. »
L’idée de reconstruire des cases témoin sur la partie au sec a traversé l’esprit de plusieurs d’entre eux, « notamment de l’association ‘Antana Be Maeva’, une sorte de marqueur de mémoire, étant donné que des cases en tige de raphia, défiant les vents et donc l’histoire des « Trois petits cochons », il n’y en a plus beaucoup à Mayotte ! « Mais la mairie s’est appropriée l’idée il y a quelques années, et veut y organiser des activités en y déposant des containeurs », critique-t-il.
Ça tombe bien Mariame Baco Ousseni, adjointe à la maire de Chirongui, en charge de la culture et du patrimoine est présente, et pointe du doigt l’association : « Justement, c’est ‘Antana Be Maeva’ qui devait animer cet atelier de construction d’un banga traditionnel, mais elle n’est pas venue. Quand on prend un engagement, il faut le tenir, de l’argent est en jeu ! », reproche-t-elle. Mais son interlocuteur reste campé sur sa position, « ça vous permet de comprendre du côté de la mairie ce que ça fait quand on ne tient pas parole ! ».
L’usine de Miréréni du père d’Adrien Giraud

On ne sait pas si un compromis a été trouvé, nous dirigeons nos pas quelques mètres plus loin, vers un bacoco, Narisilaï, qui met la dernière main à une pirogue. A travers son kibushi, et ses traducteurs improvisés, c’est toute l’histoire de l’arrivée des malgaches qui nous est racontée, « ils sont un peu dans tous les coins à l’ouest de l’île, car ils n’ont pas cherché à se regrouper tous ensemble, mais se sont installés un peu partout dans chaque village après. » La pirogue est en kapokier, et les bras de liaison en palétuvier, « à la fois solide et léger. »
En repartant vers Miréréni, une autre halte nous attendait, correctement signalée comme la première, à l’usine sucrière. Il ne faut pas s’attendre à des vestiges comme il y en a à Hajangua, ou à Soulou, mais par contre, de nombreuses machines et outils y sont mis en valeur, sur un terrain parfaitement entretenu, qu’on pourrait presque qualifier de paysagé. Une équipe de la mairie attend le peu de visiteurs venus sur site, et Toula Malidi, animatrice de l’association Les Naturalistes, nous refait aussitôt remonter le temps à l’époque de Louis Philippe, « qui décidait en 1845 de faire de Mayotte une colonie sucrière. »
On connaît la suite, les 17 usines, de petites dimensions, avec chacune leur exploitation de canne à sucre, les travailleurs « engagés », comme déclinaison des esclaves désormais interdits, et le déclin lié à la crise de 1883-1885. Les plantations mahoraises sont touchées par la concurrence des betteraviers européens et des plantations caribéennes et par un accès plus restreint au crédit.
« La dernière usine à fermer fut celle de Dzoumogné en 1955 ». La tour principale trône toujours au milieu du collège. Celle où nous sommes à Miréréni, dont il ne reste plus que quelques pierres, appartenait à François Giraud, le père de feu le sénateur Adrien Giraud. « Les industriels qui tenaient ces usines venaient de La Réunion, de Madagascar ou des Comores. »
Les outils et machines étaient importés, « celles de l’usine de Soulou venaient de Nantes ». L’usine sucrière de Soulou a été retenue par Stéphane Bern pour bénéficier du loto du patrimoine, « c’est la mieux conservée, ainsi que sa jetée. » Et ça vaut le coup de s’y arrêter ce dimanche, Toula Malidi vous y attendra pour refaire vivre les lieux. Toutes les animations sur le Programme JEP 2018.
Anne Perzo-Lafond
Lejournaldemayotte.com















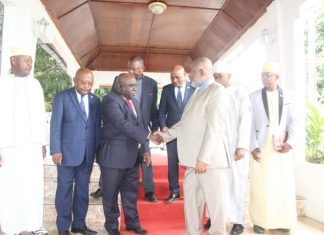



Comments are closed.