“L’esclavage existe toujours à Mayotte !” Alors que les discours liminaires à la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage commençaient sur le parking du cinéma Alpa Joe à Mamoudzou ce mardi matin, un passant participait à sa manière en donnant de la voix avant de quitter les lieux en voiture. Sans toutefois perturber plus avant la cérémonie.
Si l’esclavage moderne n’a pas été à proprement parler évoqué lors de cette célébration, les éléments historiques et anthropologiques abordés éclairent la société mahoraise d’aujourd’hui autant que son passé.
Premier à prendre la parole, le président du conseil départemental Soibahadine Ibrahim Ramadani rappelait la base :
“En cette année 2021 nous célébrons le 175e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à Mayotte, intervenu par ordonnance royale de Louis-Philippe le 9 décembre 1846 et en même temps nous célébrons le 73e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU en 1948. En cette matière Mayotte fait œuvre de précurseur dans l’ensemble français puisque cette abolition est intervenue un an et demi avant le décret libérateur de 1848.”
La date du 27 avril a été choisie par l’assemblée départementale pour célébrer l’abolition chaque année depuis 1994. “Plus qu’une habitude, c’est une obligation de mémoire” poursuivait le président du Département. Car selon lui, et ce postulat a guidé toute la conférence qui a suivi, “cette traite négrière et l’esclavage dans notre partie du monde a laissé des traces, des stigmates pour notre génération à nous”, et s’il existe un déni de cette réalité historique, “son héritage tapisse encore nos personnalités”.
Ainsi, si l’esclavage a été introduit à Mayotte il y a près de 1000 ans par les arabo-chiraziens, “l’arabisation a été idéalisée au point que tout ce qui n’est pas arabe est sous-évalué” à Mayotte analyse le chef de l’exécutif local, féru d’histoire. Il en veut pour preuve le terme swahili et shimaore “Ustaarab”, qui désigne la “manière arabe”. Par extension, ce mot issu de l’arabe “arabiser” a pris le sens de “civilisé”.
“Chez nous c’est celui qui a les bonnes manières, sous entendu « à l’arabe ». On n’a pas d’autre mot” précise Abdloulkarime Ben Saïd, directeur du Musée de Mayotte. Par extension “c’est devenu un mot qui désigne toute bonne façon de faire” ajoute ce dernier.
Ce qui n’est pas sans conséquence. L’influence arabe à Mayotte a ancré des préjugés dans la langue et la culture, et pénalisent l’analyse qui peut être faite du passé de Mayotte en lien avec l’esclavage.
“Les mots makua, M’chambara, noms d’ethnies africaines, équivalent de nos jours à des insultes” déplore le président Soibahadine. “Pourtant ce sont des groupes ethniques. C’est dire si dans la profondeur de nos consciences, l’inculcation des valeurs à la manière des arabes nous amène à dénigrer tout ce qui est noir et donc, tout ce qui est africain. Certains d’entre nous à Mayotte vont jusqu’à dire nous on n’est pas africains !”
Outre l’esclavage pratiqué par les Arabes, le président du CD revenait aussi sur celui imposé par des chefs locaux à leurs peuples respectifs, ce qui influencerait encore aujourd’hui les noms de villages comme Nyambotiti. Ce passé a créé selon le président Soibahadine des “cicatrices qui ont du mal à se refermer tant pour les descendants des anciens chefs que pour ceux des victimes. C’est ainsi que ce lourd passé pèse encore sur nos consciences au moment où je vous parle. Ce sont quelques aspects de la réalité de l’esclavage à Mayotte.”
L’arrivée de Mayotte dans le giron français en 1848 n’a pas suffi à tourner la page de l’esclavage sur l’île.
“Le 9 décembre 1846 le roi Louis Philippe fit table rase de ce passé infamant, mais le système d’engagement des travailleurs dits libres dut détourné sciemment par les planteurs locaux. Ils ont développé un esclavagisme colonial avec son lot de violences, de mauvais traitements voire de salaires impayés, et l’administration coloniale a fermé les yeux, transformant de fait les engagés libres en esclaves. C’est cela aussi la mémoire de l’esclavage à Mayotte.” Et le président d’évoquer les révoltes d’engagés, réprimées dans le sang. “1856, 1866 ou encore 1876 sont des années de révolte des travailleurs engagés. Toutes ont été réprimées dans le sang mais ne sont pas restées vaines, ces insurrections ont contribué à pousser la justice à se préoccuper du sort de ces engagés livrés aux seules lois de leurs propriétaires. C’est un pan de la mémoire de Mayotte qui ne peut pas être passé sous silence.”
Pour l’élu local, le mandat qui se termine aura été l’occasion “de lutter contre le déni, le silence et le désintérêt des Mahorais pour les questions de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs héritages qui irriguent encore notre société et nos identités. Nous avons impulsé une dynamique mémorielle palpable depuis plus de 3 ans” en inaugurant une stèle, puis un livre dédié à l’histoire de l’esclavage à Mayotte et bientôt, un autre ouvrage sur l’histoire généraliste de l’île.
Les Mahorais, des Samboussas qui s’ignorent ?

Dans son analyse, le président était rejoint par le chercheur en linguistique Abderemane Mohamed qui voit dans l’histoire arabisée de Mayotte une “bipolarisation”. Le vocabulaire, les manières de parler de l’Afrique apportées par les commerçants arabes ont façonné une certaine perception des Mahorais de leurs voisins et de leur histoire surtout.
“Les arabo musulmans ont imposé une nouvelle civilisation, d’où ce monde binaire : le monde négro-africain-bantou, primitif, sauvage barbare, tout ce vocabulaire négatif, et de l’autre côté, le Ustaarab, l’arabisé, l’islamisé, qui est civilisé, raffiné, ouvert d’esprit. Nous avons jusqu’à présent toujours fonctionné avec ce monde binaire de sorte que nous n’avons jamais cherché un autre mot pour remplacer le mot civilisation, nous n’avons pas d’autre mot dans tout l’archipel que l’Ustaarab, c’est problématique”, juge l’enseignant. “Car ça veut dire que nous pouvons toujours commémorer, il y a une autre part de travail. En tant que professeur de lettres j’ai beaucoup publié de contes, et je me suis rendu compte que les contes entretiennent cette idéologie dominante et dominée. Dans un conte, une jeune esclave a fait une tentative de libération, elle a pris la place de sa maîtresse qui devient alors esclave et prend conscience. Mais à la fin du conte les choses redeviennent ce qu’elles étaient avant. J’ai pris la décision de modifier la fin de ce conte pour montrer que l’esclave peut se libérer, sinon on dit aux jeunes, tu ne pourras jamais t’en sortir. Cela demande un travail de réécriture de nos mythes, légendes et contes, qui sont la première école de nos jeunes. On ne peut pas d’un coté leur apprendre qu’ils ne s’en sortiront jamais, leur dire que la référence de la beauté est arabe, et à l’école républicaine, leur dire que l’esclavage n’est pas bon.”
Revenant sur la pique du président du CD concernant ceux qui se disent “pas africains” à Mayotte, le chercheur apportait une autre manière d’aborder la question.
“Qui sommes nous ? Sommes nous arabes ou africains ? Quelle question idiote ! Quand vous achetez des samboussas, vous vous demandez si c’est de la farine, de la viande ou des oignons ? Jamais ? Les trois ingrédients forment un nouveau produit qui s’appelle samboussa. Nous sommes Mahorais, un produit né de la rencontre de tous ces ingrédients. Les contes makua, il y en a beaucoup à Mayotte, le turban porté pour le grand mariage, ce n’est pas un turban omanais, là bas c’est le sultan qui le porte, ici c’est le marié, c’est un turban mahorais. Quand parlera-t-on du Mahorais, du Samboussa, et non de ses ingrédients ?”
Deux mots qui faussent l’histoire

On l’a vu plus haut, l’Ustaarab (ou Usta’rab) est une notion profondément ancrée dans le vocable mahorais qui peut biaiser la perception de l’histoire de l’île. Mais il en est un autre qui rend encore plus complexe l’appréhension de l’esclavage : l’Urumwa.
Ce terme, communément utilisé pour traduire “esclavage” en shimaore, est le même que pour engager, recruter, mandater ou asservir. Urumwa bure (embaucher gratuitement) est une manière de préciser la notion d’esclavage, mais elle fait l’impasse sur l’engagisme, théoriquement rémunéré. Ce mot unique “peut contribuer à créer un quiproquo” concède le directeur du MuMa. On le voit dans le monde judiciaire, quand un juge peine à faire traduire la notion d’esclavage moderne à un prévenu qui rémunère un Comorien 50€ par mois, ou qu’il faut faire comprendre la différence entre exploiter et employer.
Autant d’éléments de langage qui ont leur utilité dès lors qu’il s’agit de vulgariser, enseigner et retranscrire un passé aussi long que riche, fait de plus de 1000 ans d’échanges culturels, linguistiques, commerciaux et surtout humains. Mais aussi pour poser les bons mots sur des pratiques qui, comme le lançait avec véhémence le badaud cité en tête d’article, persistent, plus d’un siècle et demi après l’abolition officielle de l’esclavage.

C’était le sens du propos de la sous-préfète Laurence Carval, directrice de cabinet du préfet, qui rendait hommage à la loi Taubira de 2001. “Il y a 20 ans tout juste, la République reconnaissait solennellement la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Cette commémoration pourrait n’être qu’un rendez-vous annuel si elle ne s’inscrivait dans un temps plus long, celui du mois des mémoires, où tous les mots ont un sens (…) l’occasion pour la nation toute entière de regarder franchement son passé, de construire ensemble sa mémoire commune, aussi douloureuse soit-elle, et de mesurer le chemin parcouru. (…) il est naturel que le travail de recherche rejoigne le travail pédagogique, celui de la contextualisation et de la transmission” afin que chaque citoyen “s’approprie ce passé collectif et son attachement aux valeurs de dignité humaine et de respect mutuel”. Dès lors, le travail n’appartient plus aux historiens. “Selon l’ONU, l’esclavage contemporain concerne encore plus de 40 millions de personnes dans le monde” rappelait la représentante de l’Etat.
Y.D.














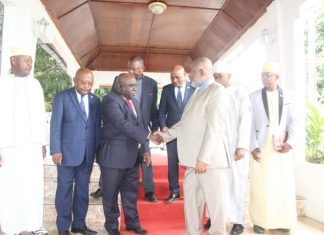



Comments are closed.