Avant la “journée internationale de la femme” ce 8 mars, le JDM vous propose de rencontrer des femmes de Mayotte. Aujourd’hui, Roukia, infirmière en cancérologie au CHM raconte un peu de son parcours.
 «Si on commence par le début, je suis née à Dzaoudzi il y a 52 ans.» Roukia est une petite dame aussi attachante que bavarde. Elle adore raconter des histoires même si la sienne, elle n’en parle pas si souvent. Mais elle sait écouter aussi. A l’hôpital de Mayotte où elle est infirmière, elle s’occupe des patients atteints d’un cancer.
«Si on commence par le début, je suis née à Dzaoudzi il y a 52 ans.» Roukia est une petite dame aussi attachante que bavarde. Elle adore raconter des histoires même si la sienne, elle n’en parle pas si souvent. Mais elle sait écouter aussi. A l’hôpital de Mayotte où elle est infirmière, elle s’occupe des patients atteints d’un cancer.
«J’aime mon métier et j’aime spécialement ce service parce que c’est très particulier. On a à faire à des patients démunis de tout. Les deux tiers sont clandestins. Quelqu’un qui est affilié à la Sécu, qui a un chez lui, de l’eau potable, de l’électricité, il ne vit pas sa maladie de la même façon que quelqu’un qui a des proches et quelque chose de construit autour de lui. On est infirmière, oreille attentive, assistante sociale, on est aussi la personne qui écrit des lettres parce que ces gens ne savent pas écrire et on leur demande de rédiger des tas de choses pour la préfecture.»
Partager les problèmes des autres
Roukia est une femme du Canal du Mozambique, née à une époque où on pouvait circuler facilement dans la région. Quand sa mère se remarie avec un commandant de la marine marchande, la famille quitte Mayotte pour Anjouan où elle commence le collège. «Et puis, en 1975, avec le coup d’Etat, mon père avait le bateau qui était chargé d’évacuer tous les politiques vers Madagascar. Alors, on s’est installé à Majunga. Ensuite, c’est à Mada qu’il y a eu des incidents, alors on est repartis à Anjouan où je suis allée au lycée avant de rentrer à Mayotte en 1980.»
 Mais à cette époque, il n’y avait absolument aucun travail dans l’île au lagon à moins de devenir instituteur. «Moi, c’était pas mon truc. Je n’avais pas la patience d’expliquer les choses aux enfants. Je préférais être au chômage plutôt que de devenir instit.» Alors, pourquoi pas l’hôpital. Elle passe le concours, à contre cœur, pour entrer à l’école locale d’infirmière et c’est là qu’elle va apprendre à aimer son métier. «C’est Josiane Henry, qui était directrice et formatrice, qui m’a permis de découvrir le rapport entre le soignant et le soigné, à partager les problèmes des autres, à les écouter. J’avais 19 ans à l’époque…»
Mais à cette époque, il n’y avait absolument aucun travail dans l’île au lagon à moins de devenir instituteur. «Moi, c’était pas mon truc. Je n’avais pas la patience d’expliquer les choses aux enfants. Je préférais être au chômage plutôt que de devenir instit.» Alors, pourquoi pas l’hôpital. Elle passe le concours, à contre cœur, pour entrer à l’école locale d’infirmière et c’est là qu’elle va apprendre à aimer son métier. «C’est Josiane Henry, qui était directrice et formatrice, qui m’a permis de découvrir le rapport entre le soignant et le soigné, à partager les problèmes des autres, à les écouter. J’avais 19 ans à l’époque…»
Des études pour l’avenir
Son diplôme mahorais en poche, Roukia ne s’en est pas contentée. Après deux ans à la maternité de Sada, elle a suivi le conseil de son père: «Si à Mayotte, on va vers un département, ton diplôme local ne vaudra plus un clou.» Alors, elle est partie en métropole pour une école d’infirmière reconnue nationalement. «A Bobigny, il y avait un internat et à l’époque, faute de moyens, je n’avais pas le choix. En échange, j’ai dû passer cinq ans dans les hôpitaux de Paris.»
En 2001, elle décide de rentrer chez elle. «Je me suis toujours dit que je serais plus utile chez moi que là-bas. J’ai toujours constaté que les malades, quand ils ont à faire à une tierce personne pour traduire, ils se freinent pour dire les choses. Moi, j’ai un avantage sur mes collègues de métropole. Et puis je suis presque la plus âgée et les patients âgés, ils ont tendance à me demander.»
Faire comprendre à ses enfants la chance qu’ils ont
 Roukia estime avoir eu de la chance de pouvoir se marier très tard. «J’ai toujours eu des parents qui ont su évoluer avant la société, ils voyaient plus loin que leur époque. Je me suis mariée à 29 ans et j’ai eu ma première fille à 31 ans. C’est très rare pour les femmes de ma génération. Autour de moi, elles sont toutes grand-mères !»
Roukia estime avoir eu de la chance de pouvoir se marier très tard. «J’ai toujours eu des parents qui ont su évoluer avant la société, ils voyaient plus loin que leur époque. Je me suis mariée à 29 ans et j’ai eu ma première fille à 31 ans. C’est très rare pour les femmes de ma génération. Autour de moi, elles sont toutes grand-mères !»
Elle a raconté son parcours à ses trois enfants, nés en métropole, pour qu’ils réalisent la chance qu’ils ont eux-aussi. «Moi, j’ai dormi dans le métro à Paris quand je n’avais pas d’argent. Et puis, je veux qu’ils réalisent aussi qu’autour d’eux, aujourd’hui à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas faire d’études parce qu’ils n’ont pas les moyens ou pas de papiers. »
Roukia pourrait prendre sa retraite dans quatre ans mais elle va peut-être continuer un peu «si on m’autorise. Quand mon père est mort d’un cancer, je n’étais pas là. Alors, tous les jours, je me dis que ce que je fais pour les patients, j’espère que d’autres l’ont fait pour mon papa.»
RR














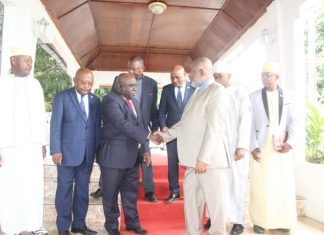



Comments are closed.